À l’été 1967, Ronald Blythe a pédalé de sa maison dans le hameau Suffolk de Debach au village voisin de Charlsfield. Là, il a écouté les voix des forgerons, des fossoyeurs, des infirmières, des cavaliers et des éleveurs de porcs. Il leur a donné des noms sur des pierres tombales et les a placés dans un village fictif. Akenfield, portrait d’une vie rurale en voie de disparition rapide, a été immédiatement acclamé comme un classique lors de sa publication en 1969.
Jamais épuisé et lu et étudié dans le monde entier, Akenfield a rendu Blythe célèbre et a peut-être éclipsé les nombreux autres fruits de ses longues années d’écriture – nouvelles, poèmes, histoires, romans et, plus tard dans la vie, des essais lumineux et un superbe hebdomadaire. journal que le Church Times a publié pendant 25 ans jusqu’en 2017. Blythe, décédé à l’âge de 100 ans, est considéré par ses pairs et de nombreux lecteurs comme le meilleur écrivain contemporain de la campagne anglaise.
Aînée de six enfants, Blythe est née à Acton, près de Lavenham, dans une famille d’ouvriers agricoles enracinée dans le Suffolk rural. Son nom de famille vient de la Blyth, une petite rivière du Suffolk, mais sa mère et sa famille étaient londoniennes. Sa mère, Matilda (née Elkins), infirmière, lui a transmis son amour des livres. Bien que Blythe ait quitté l’école à 14 ans, il avait déjà établi une habitude de lecture vorace – « jamais à l’intérieur, où l’on pourrait avoir quelque chose à faire », se souvient-il – qui est devenue son éducation.
Son père, Albert, avait servi dans le Suffolk Regiment et combattu à Gallipoli et Blythe fut enrôlé pendant la seconde guerre mondiale. Au début de sa formation, ses supérieurs ont décidé qu’il était inapte au service – des amis disaient qu’il était incapable de blesser une mouche – et il est retourné à East Anglia pour travailler, tranquillement, comme bibliothécaire de référence à la bibliothèque de Colchester.
Il s’est lié d’amitié avec des écrivains locaux, dont le poète James Turner, qui a contribué à son passage dans un cercle bohème et créatif du Suffolk qui comprenait Sir Cedric Morris, qui a enseigné à Lucian Freud et Maggi Hambling et a vécu à proximité avec son partenaire, Arthur Lett-Haines. Blythe « aspirait à être écrivain », a-t-il dit, et il a écouté et appris – inspiré par l’exemple d’amis poètes, dont Turner (le poète anonyme d’Akenfield) et WR Rodgers, sur la façon de vivre avec très peu d’argent. « C’était une sorte d’apprentissage », se souvient-il un jour.
Surtout, en 1951, il rencontre l’artiste Christine Kühlenthal, épouse du peintre John Nash. Kühlenthal a encouragé son écriture et l’a défendu : Blythe a édité les programmes du festival d’Aldeburgh pour Benjamin Britten et a même fait des courses pour EM Forster, qui a fait briller le jeune homme timide. Blythe a aidé Forster à compiler un index pour la biographie de Forster de 1956 sur sa grand-tante, Marianne Thornton.
Le premier roman de Blythe, inspiré de Forster, A Treasonable Growth, a été publié en 1960. Il l’a suivi en 1963 avec The Age of Illusion, une histoire sociale de la vie en Angleterre entre les deux guerres. Il gagnait de l’argent grâce au journalisme, étant « lecteur » d’éditeurs et éditant une série de classiques – dont l’un de ses héros, l’essayiste William Hazlitt – pour la Penguin English Library.

Après un passage à Aldeburgh, rappelé dans un mémoire élégiaque et typiquement discret, The Time by the Sea (2013), il s’installe dans un cottage à Debach. Au milieu des années 1960, il se lie d’amitié avec la romancière américaine Patricia Highsmith. « Je l’admirais énormément. C’était une femme très étrange et mystérieuse. Elle était lesbienne mais en même temps elle trouvait les corps des hommes beaux », se souvient-il. Un soir, après une soirée littéraire parisienne, ils couchèrent ensemble ; il a dit à un ami qu’ils étaient tous les deux curieux « de voir comment l’autre moitié l’a fait ».
Blythe a déclaré que l’idée d’Akenfield (il a pris le nom du vieil anglais « acen » pour gland) est arrivée alors qu’il parcourait les champs du Suffolk en pensant à l’anonymat de la vie de la plupart des ouvriers agricoles. Son ami Richard Mabey se souvient qu’il a été commandé par Viking comme titre principal d’une série éphémère sur la vie des villages à travers le monde.
Au cours de 1967 et 1968, il a écouté les citoyens de Charsfield, recréant des voix country authentiques tout en y ajoutant sa propre poésie. Il en résulte un portrait de la « gloire et de l’amertume » de la campagne : la misère et pourtant la fierté profonde de l’ancienne vie paysanne quasi féodale, et son effacement dans les années 1960 par une seconde révolution agricole parallèlement à l’arrivée de la voiture et de la voiture. télévision.
Les voix du village n’ont jamais été sentimentales à propos de la vie à la campagne, et Blythe non plus : en plus des histoires sur la fabrication de chariots de maïs, il y a eu des révélations discrètes d’inceste, et l’infirmière du district a raconté l’ancien temps où les personnes âgées étaient entassées dans des placards. Les vieux ouvriers se souvenaient de la « méchanceté » des agriculteurs qui avaient traité leurs ouvriers comme des machines parce que les grandes familles rurales livraient une quantité apparemment inépuisable de fourrage agricole.
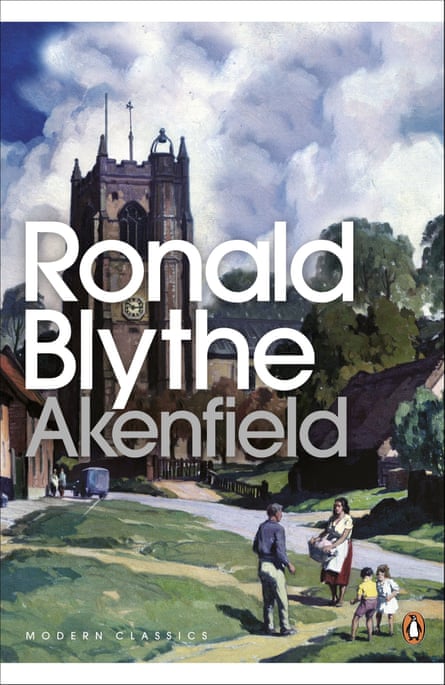
Les critiques enthousiastes de ce livre « exceptionnel » et « délicieux » en Grande-Bretagne se sont répandues en Amérique du Nord, où Time l’a loué, John Updike l’a adoré et Paul Newman a voulu le filmer. Mais certains historiens oraux se méfiaient du fait que Blythe n’avait pas enregistré ses conversations.
Blythe a refusé une offre de film de la BBC mais a finalement accepté un pitch du directeur de théâtre Peter Hall, un autre homme du Suffolk. Blythe a écrit un nouveau synopsis inspiré du livre infilmable, et Hall a demandé aux ruraux ordinaires d’improviser des scènes sans scénario. Blythe a supervisé chaque jour le tournage et a joué un camée approprié en tant que vicaire. Près de 15 millions de personnes ont regardé Akenfield lors de sa diffusion sur London Weekend Television au début de 1975.
Le prochain livre de Blythe, The View in Winter (1979), était un examen prémonitoire de la vieillesse dans une société qui ne la valorisait pas, à une époque où plus de gens que jamais l’atteignaient. Le « désastre » subi par les anciens, écrit-il, c’est que « personne ne les voit plus comme ils se voient eux-mêmes ». Blythe le considérait comme son meilleur livre. Pendant qu’il l’écrivait, Kühlenthal mourut et Blythe emménagea dans l’ancienne ferme des Nash, Bottengoms, pour s’occuper du vieux Nash. Lorsque Nash mourut un an plus tard, il laissa la maison à Blythe. Là, Blythe a vécu pour le reste de sa vie, écrivant magnifiquement sur sa maison dans At the Yeoman’s House (2011).
Plus tard, Blythe a attiré des éloges pour ses nouvelles et ses essais, y compris une série de méditations sur le poète rural du XIXe siècle John Clare. De nombreux écrivains regroupés plus tard sous le nom d’« écrivains de la nature » devinrent ses amis, dont Mabey, Robert Macfarlane et Roger Deakin.
Blythe ne s’est jamais marié, n’a jamais vécu avec personne et a gardé sa vie personnelle voilée. Interrogé par The Observer en novembre 1969, il est jugé « intensément privé ». Il n’a rien révélé dans ses écrits publiés sur ses amours avec les hommes, ni même sur son aventure d’un soir avec Highsmith.

Il était presque aussi réticent à propos de sa foi, mais son écriture était profondément imprégnée de ses croyances chrétiennes et de sa connaissance des Écritures. Il était un lecteur laïc – remplaçant les vicaires dans plusieurs paroisses – et est devenu chanoine laïc de la cathédrale St Edmundsbury, mais a refusé la possibilité de devenir prêtre.
Rowan Williams, l’ancien archevêque de Cantorbéry et admirateur de l’écriture de Blythe, pensait que Blythe utilisait l’année chrétienne des festivals comme «une toile de fond stable» pour son écriture et sa pensée, libérées par sa foi. L’écrivain Ian Collins, un bon ami de Blythe dans ses dernières années, a estimé que c’était le manque d’éducation formelle ou de «formation» de Blythe qui avait libéré sa pensée originale et son style de prose élégant.
Blythe a été politiquement radical tout au long de sa vie, un électeur travailliste qui a rejoint les vigiles pour la paix à l’extérieur de St-Martin-in-the-Fields à Londres. Des amis ont été surpris lorsqu’il a accepté un CBE en 2017, à peu près au moment où il a été doucement «retraité» de la parole et de l’écriture en public alors que sa mémoire à court terme s’estompait. Lorsqu’il a atteint 100 ans, il était encore assez bien pour signer 1 500 exemplaires d’une nouvelle compilation de ses meilleures chroniques du Church Times.
Les personnes âgées qui ont prospéré dans The View in Winter étaient celles, a conclu Blythe, qui ont pu préserver leur « vitalité spirituelle, une vivacité, une sorte d’énergie imaginative ». Ce credo lui a bien servi en vieillissant, bien qu’il se soit trompé sur un autre point. Les anciens, écrit-il, sont « soignés, entourés de bienveillance, et les gens s’intéressent souvent à ce qu’ils disent ; mais ils ne sont pas vraiment aimés et ils le savent ».
Blythe était très aimé plus tard dans la vie. Une liste d’amis dévoués qu’il appelait ses « êtres chers » lui rendait visite quotidiennement, lui fournissait des repas chauds et s’assurait qu’il puisse vivre ses années à Bottengoms.